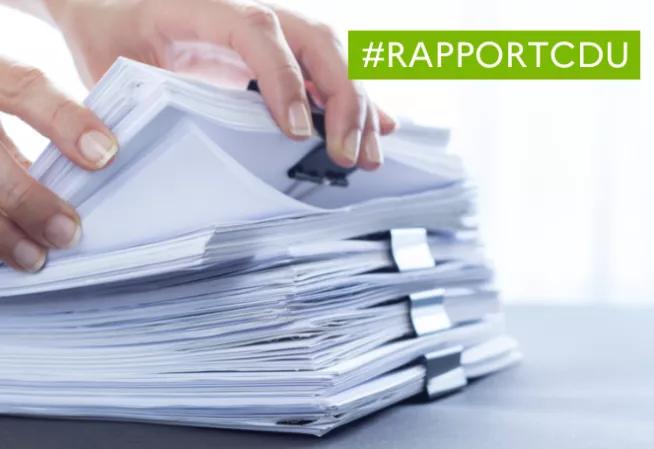Ils portent la voix des personnes, patients, proches, aidants et usagers au sein du système de santé, font remonter leurs préoccupations, défendent leurs droits individuels et collectifs, participent à l’amélioration des prises en charge… Officiellement reconnus par la loi Kouchner de 2002, les représentants des usagers (RU) sont aujourd’hui des acteurs clés de la démocratie en santé. « Un RU est un bénévole d’une association agréée en santé, désigné par le directeur général de l’ARS pour siéger dans des instances comme la commission des usagers (CDU) d’un établissement de santé. Il est formé pour réaliser cette mission », explique Léa Redon, chargée de mission à la délégation régionale Île-de-France de France Assos Santé, une union d’associations agréées.
Déployées dans tous les établissements de santé depuis 2005, les commissions des usagers sont des espaces de dialogue et de débat entre les professionnels et les usagers pour améliorer le fonctionnement et l’organisation des établissements. « Elles se réunissent tous les trimestres pour aborder de nombreux sujets : les plaintes et réclamations, mais aussi la qualité de l’accueil, l’information donnée aux usagers, les actions à mettre en place pour améliorer le bien-être des patients, les pratiques des personnels de santé ou administratifs… Les RU sont attendus pour transmettre les besoins et les observations des usagers qu’ils représentent mais aussi pour faire des propositions concrètes. Leur rôle n’est pas médical, mais surtout politique », précise Léa Redon. Si les CDU sont leurs principaux terrains d’actions, les représentants des usagers peuvent également siéger aux conseils de surveillance et d’administration des établissements ou s’impliquer dans différents organes de concertation, sur l’alimentation, la lutte contre la douleur, les infections liées aux soins… « En dehors des établissements de santé, d’autres instances comptent également des représentants des usagers dans leur tour de table, ajoute Marion Lambolez, responsable du déploiement de la démocratie en santé et de la participation usagers à l’ARS Île-de-France. C’est le cas notamment de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), des Conseils territoriaux de santé (CTS), des commissions de protection des personnes (CPP), ou encore des conseils des Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), par exemple. »
Une fonction à valoriser
Cette année, l’ARS renouvelle l’ensemble des mandats des représentants des usagers actifs en Île-de-France. « Les textes prévoient 4 RU par établissement (2 titulaires et 2 suppléants) ce qui correspond à presque 1600 postes en Île-de-France. En pratique, 36% des mandats sont vacants, constate Léa Redon. Les raisons sont multiples : d’une part, le mandat de RU est un poste bénévole et suppose donc un engagement qui peut être difficile à prendre (manque de temps, motivation). D’autre part, l’existence des RU ainsi que leurs rôles restent grandement méconnus, même des professionnels de santé. Les RU souffrent aussi parfois d’un manque de reconnaissance. Dans certains établissements, il n’y a plus de RU, dans d’autres, ils peinent à s’impliquer ou à être considérés comme des partenaires. »
Pour changer la donne, l’un des objectifs phare du projet régional de santé 2023-2028 est de renforcer le pouvoir d’agir des habitants, des usagers et des citoyens. Dans ce cadre l’ARS a lancé fin 2024, en lien avec la CRSA, un groupe de travail associant France Assos Santé, des RU, des établissements et des professionnels de l’ARS. Objectif : produire une feuille de route commune d’ici fin 2025, articulée autour de quatre axes : mieux faire connaître le rôle de RU et le valoriser, encourager leur implication par les établissements de santé, rompre l’isolement des RU en renforçant l’animation de réseaux, et fluidifier les processus de désignation. “Les bénévoles et les associations sont très investis pour répondre aux besoins dans les établissements. Il est important que ces derniers se mobilisent également pour promouvoir cette fonction, et accueillir davantage de RU au-delà du besoin imminent lorsque qu’ils sont à la veille de leur visite de certification.” rappelle Marion Lambolez.
De son côté, France Assos Santé poursuit sa mission de formation des RU — à travers un socle de base obligatoire (à destination de l’ensemble des associations qu’elles soient adhérentes à France Assos Santé ou non) et une offre élargie de modules thématiques — ainsi que l’animation de son réseau régional. Des propositions d’évolution réglementaire font aussi l’objet d’un plaidoyer, par exemple pour adapter le nombre de représentants des usagers à la taille de l’établissement.
Des usagers acteurs
La participation des usagers ne se limite pas aux instances de représentation. « En Île-de-France, d’autres formes d’implication plus diversifiées émergent, notamment dans certaines maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) ou à l’échelle territoriale où les usagers peuvent être associés dès l’élaboration du projet de santé, ou invités à contribuer à des réflexions sur l’accueil, l’écologie ou le numérique, par exemple », observe Marion Lambolez.
Cette logique de co-construction s’incarne aussi dans des démarches comme le Comité des personnes directement concernées par le handicap (CPCH), créé en 2024 par l’ARS Île-de-France. Composé de 30 personnes, ce comité formule des propositions sur des sujets tels que l’accès aux droits, l’habitat ou l’inclusion. « L’idée, c’est de créer des espaces où les personnes concernées peuvent s’exprimer sur les politiques publiques qui les concernent et les touchent au quotidien, au-delà des cadres réglementaires existants permettant cette expression », précise Marion Lambolez.
De la représentation à la participation, un continuum d’engagement se dessine. Il inclut aujourd’hui les représentants des usagers mais aussi les patients partenaires, patients experts ou pairs aidants, dont les rôles se développent dans les établissements, la médecine de ville, la recherche ou la formation et plus largement via la participation citoyenne.
En 2025, l’ARS a lancé un état des lieux du partenariat en santé pour identifier les pratiques existantes et les besoins des établissements, des professionnels et des usagers, afin de préparer le déploiement d’une stratégie visant à renforcer la participation et le rôle des patients partenaires dès la fin de l’année.
Des modalités différentes, mais un même objectif : faire de l’expérience vécue une expertise et un levier d’action.
Focus
À Savigny-sur-Orge, des patients en action
À la MSP des Bleuets, un comité des usagers s’est constitué à l’initiative de patients. En un an et demi, ce petit groupe a renforcé le dialogue avec les soignants et contribué à faire évoluer certaines pratiques.
Implantée à Savigny-sur-Orge depuis 2018, la maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) des Bleuets fédère 17 professionnels de santé – médecins généralistes, psychologues, infirmières, kinésithérapeutes, psychiatre, diététicienne ainsi qu’un enseignant en activité physique adaptée – répartis sur trois sites. Elle abrite également la Maison Sport Santé - portée par l’association Bien-être des Coquelicots - qui réalise des bilans de compétences physiques et propose un riche programme d’activités physiques et sportives individuelles et collectives. Pensée initialement pour combler le grand nombre de départs à la retraite de médecins sur la commune, la MSP a rapidement trouvé son public et compte désormais plus de 6000 patients.
Acteurs de leurs parcours
« Il y a un an et demi, nous avons constitué un comité des usagers à l’initiative de deux personnes qui souhaitaient porter la voix des patients et faire part de leurs attentes », explique Virginie Trumeau, infirmière de pratique avancée et relais interne du comité des usagers. Soria Mokhtari fait partie des deux pionniers : « Nous suivions alors un programme d’activité physique adaptée (APA) et progressivement nous avons eu envie de devenir davantage acteurs de notre parcours de santé. Après avoir pris part à des projets autour de l’APA l’idée de former un comité des usagers a germé. Nous l’avons proposé à l’équipe de la MSP et nous avons été entendus. »
Des résultats concrets
Aujourd’hui constitué de quatre personnes, le petit groupe a rapidement trouvé sa place. « Nous avons créé une boîte mail dédiée afin que les patients puissent nous écrire directement, pour poser une question, demander une information ou partager un ressenti, détaille Soria Mokhtari. Ce canal direct facilite la parole des usagers, qui osent parfois plus facilement s’adresser à leurs pairs qu’à un professionnel de santé. » Le comité s’est également emparé de la question de l’évaluation : un questionnaire de satisfaction, conçu et diffusé par ses membres, a permis de recueillir l’avis des patients. « Les échanges réguliers avec le comité des usagers nous permettent d’avoir un vrai retour, ajoute Virginie Trumeau. Cela nous a amenés à modifier certaines pratiques, par exemple en allongeant le temps de consultation pour améliorer l’écoute, ou en ouvrant des séances d’activité physique en soirée et le samedi pour les actifs. Cela m’a même amené à repenser mes interventions. A présent, je propose de recevoir les patients avant leur visite chez le généraliste. Ce temps d’écoute supplémentaire les soulage et fluidifie les consultations du médecin. »
Un comité qui s’autonomise
La participation des usagers dépasse la seule expression des besoins. Aux côtés des professionnels, ils accompagnent l’organisation d’événements, comme les Olympiades du sport santé, où ils tiennent un stand pour présenter le comité. Ils soutiennent aussi l’équipe dans ses démarches pour trouver des locaux adaptés aux activités collectives. « Le fait d’impliquer les patients renforce notre crédibilité auprès des partenaires et des collectivités », note Virginie Trumeau. De leur côté, les membres du comité souhaitent aller encore plus loin. « Nous aimerions organiser nos propres événements et instaurer un système de permanence avec un bureau dédié pour mieux aller à la rencontre des patients et convaincre un maximum d’entre eux de nous rejoindre, indique Soria Mokhtari en conclusion. Notre ambition est de faire du comité une véritable plateforme autonome entre soignants et usagers. »
Focus
« En rejoignant le CPCH, j'ai voulu élargir mes capacités d'agir »
Christine Hermelin est membre du Comité des personnes directement concernées par le handicap, créé par l’ARS à l’été 2024 pour éclairer ses politiques publiques liées au handicap.
Comment percevez-vous aujourd’hui la participation des personnes en situation de handicap aux instances qui les concernent ?
Il y a encore beaucoup de travail à faire pour informer les personnes handicapées, sans même parler de leur participation. À ma connaissance, il y a peu d’instances où elles sont directement mises à contribution, mais j’étais moi aussi mal informée. On a généralement le sentiment que l’on nous donne la parole pour « faire bien », sans que notre avis soit vraiment pris en compte.
Et vous, qu’est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le CPCH ?
J’ai toujours souhaité me rendre utile et aider les gens, mais je n’avais pas d’idée précise. Enfant, j’ai participé à un conseil des jeunes à la mairie de Neuilly. J’ai également fait partie du conseil de la vie sociale de mon établissement. En rejoignant le CPCH, j'ai voulu élargir mes capacités d'agir dans le champ du handicap.
Concrètement, comment fonctionne le CPCH ? Votre retour après près d'une année de participation ?
Nous sommes un groupe de 30 personnes en situation de handicap issus de toute l’Île-de-France et nous nous réunissons tantôt tous ensemble, tantôt en petits groupes d’une dizaine de personnes, pour travailler sur les sujets précis choisis lors de la première réunion, le tout dans le respect et la bienveillance. J’utilise une aide de communication pour m’exprimer, donc je pensais que ce serait compliqué. Mais l’ARS met tout en œuvre pour que chacun puisse participer au maximum (interprètes en LSF, visio, documents en FALC, etc.). En participant à ce Comité, je me sens valorisée. Mon seul regret, c’est que l’on ne communique pas beaucoup entre nous hors des réunions.
Pouvez-vous donner un exemple concret de sujet sur lequel vous avez été sollicités, et l’effet que cela a eu selon vous ?
Nous avons par exemple réfléchi à la pair-aidance : les personnes concernées, en particulier dans les établissements, connaissent mal leurs droits et ne savent pas toujours à qui s’adresser. La pair-aidance peut être un moyen d’être mieux informé. Le Comité a proposé à l’ARS d’intégrer la pair-aidance dans le cahier des charges des appels à projets. L’ARS semble d’accord, mais il faudra voir comment cela se traduit dans les faits.
Est-ce que cette expérience vous donne le sentiment d’avoir plus de pouvoir d’agir qu’avant ?
Je pense que c’est aux personnes handicapées de montrer ce dont elles sont capables, si on leur donne la parole, si on les informe de ce qu’elles peuvent faire et si on les considère comme des partenaires à part entière. Pour ma part, la participation au Comité a enrichi mes connaissances sur la politique du handicap. Désormais, je me sens plus légitime pour en parler et je souhaite continuer à travailler sur de nouveaux sujets avec le Comité.
Focus
Groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon : repenser la place des usagers pour mieux soigner
Pour le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, la commission des usagers est bien plus qu’un organe de régulation des plaintes. Professionnels et représentants des usagers (RU) y défendent une même vision : faire du retour d’expérience un levier de qualité et d’humanité.
Annabel Le Hir, secrétaire générale du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon
La Commission des Usagers joue un rôle important dans la dynamique d’amélioration continue de nos deux sites (12ème et 20ème arrondissement - Paris), qui placent depuis toujours la transparence et l'humilité au cœur de leur système de valeurs. Nos quatre RU sont impliqués. Ce sont de réels partenaires, qui nous alertent sur des dysfonctionnements du quotidien – un défaut de signalétique, l’absence d’email de confirmation d’un rdv, un parcours de soin mal compris – et qui peuvent également être force de proposition pour des améliorations concrètes. Ils ont par exemple contribué à une note sur le respect de l’intimité envoyée aux patientes avant consultation gynécologique. Ils répondent présents également en cas de médiation.
Aujourd’hui, nous voulons aller plus loin : sortir la CDU de son rôle traditionnel pour renforcer l’engagement patient. Cela implique de faire appel aux RU pour des entretiens patients, des temps d’échange dans les services, ou des participations aux staffs, comme nous l’avons déjà expérimenté par le passé dans notre service de maternité. Personnellement, j’ai à cœur de renforcer la transparence et de valoriser le rôle des représentants des usagers. J’ai participé à un groupe de travail piloté par l’ARS sur ce sujet, convaincue qu’il s’agit d’un rôle à enrichir pour qu’elle contribue pleinement à l’amélioration de la qualité du service rendu par les établissements.
Danièle Lecomte, représentante des usagers depuis 10 ans
Pour ma part, j’ai exercé toute ma carrière comme médecin anesthésiste et j’ai notamment été responsable d’une équipe mobile de soins palliatifs. Ces décennies d’expérience au contact de situations très difficiles m’ont convaincue de l’importance, pour les soignants, de mieux comprendre le vécu des patients. Maintenant que je suis à la retraite, j’ai la possibilité de porter leur voix, et c’est ce que je fais depuis dix ans à travers mes deux mandats de représentante des usagers pour le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon et la HAD (hospitalisation à domicile) de l’AP-HP. Quand j’ai cessé de pratiquer, j’ai suivi un DU sur la médiation en santé. J’ai eu quelques occasions de le mettre en pratique dans mes fonctions de RU, mais je dois bien reconnaître que cela n’a pas vraiment porté ses fruits, car les processus de médiation à l’hôpital sont très balisés. Il y aurait là un chantier à ouvrir – côté réglementation et formation – pour permettre aux RU d’incarner pleinement ce rôle de tiers neutre, indépendant et impartial.
Je regrette aussi que nos missions soient si peu connues. De façon générale, les établissements tendent encore trop souvent à nous invisibiliser, et les associations auxquelles nous sommes rattachés restent timides. Là aussi, il y a matière à réflexion pour l’avenir.