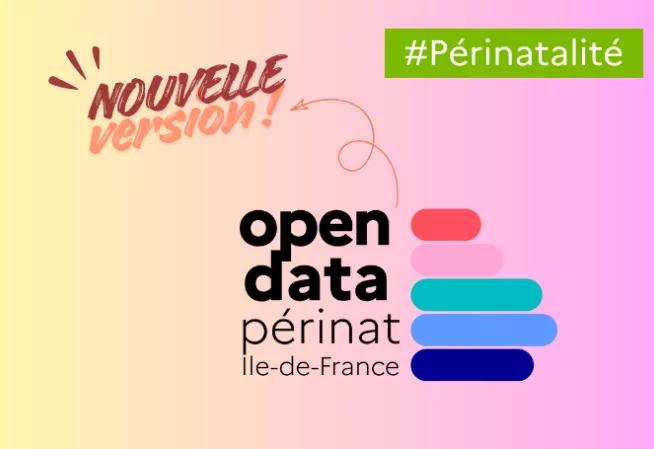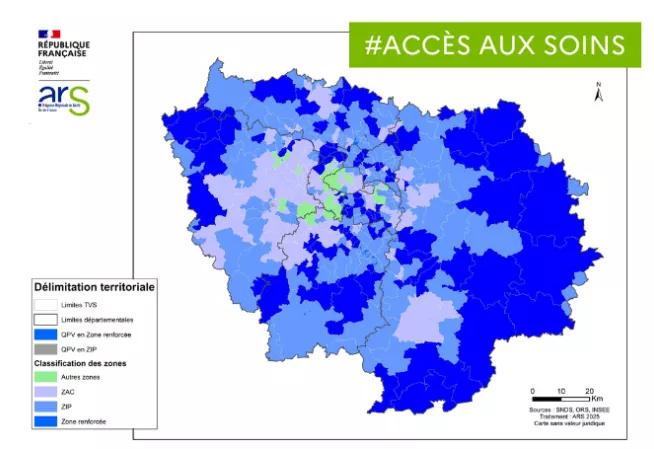La Pr Louise Potvin, spécialiste des inégalités de santé au Québec, a introduit le webinaire en soulignant que contrairement aux idées reçues, le système de santé ne contribue qu’à hauteur de 10 % aux disparités de santé.
En revanche, d’autres facteurs sont majeurs : 25 % relèvent de l’environnement (logement, qualité de l’air, accès aux infrastructures), 30 % des comportements individuels (alimentation, activité physique, consommation de substances) et une part importante est liée aux conditions socio-économiques.
Sir Michael Marmot, spécialiste des inégalités de santé au Royaume-Uni, a rappelé que depuis 2010 l’espérance de vie parmi les communautés les plus pauvres a cessé de progresser et que, dans certains cas, elle a même reculé. Pour le Pr Marmot, les politiques publiques d’austérité ont aggravé les inégalités, un phénomène amplifié par la crise du COVID-19. « La pandémie a joué le rôle de révélateur et d’accélérateur des fractures sociales », souligne-t-il.
Des réponses locales pour des enjeux globaux
Sir Michael Marmot a poursuivi la discussion en indiquant que face au désengagement de certains États, des initiatives locales se multiplient. Par exemple au Royaume-Uni, plusieurs villes comme Coventry et Manchester ont adopté les recommandations du rapport Marmot, en intégrant les déterminants sociaux de la santé dans leurs politiques publiques.
L’idée est simple : une ville qui agit sur l’éducation, le logement ou l’emploi améliore directement la santé de ses habitants.
À Montréal, souligne Pr Louise Potvin, une approche similaire se développe depuis plus de 10 ans. Le directeur de la santé publique de la ville avait depuis très lontemps placé la lutte contre les inégalités sociales de santé en tête de ses priorités. Des « tables de quartier » permettent d’identifier les besoins des habitants et de co-construire des solutions : développement de marchés populaires proposant des aliments frais à bas prix, médiation sociale et culturelle, soutien aux initiatives locales. « Ce n’est pas une révolution, mais ces actions ont un réel impact », témoigne Pr Louise Potvin.
Questions / réponses - temps d’échange avec le public :
- Même si le système de santé ne compte que 10 % des inégalités de santé, ce n'est pas négligeable et ça nous concerne directement. Que peuvent faire les professionnels de santé pour "faire partie de la solution plutôt que du problème" ?
Les professionnels de santé ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre les inégalités. Si leur action individuelle ne peut pas tout résoudre, ils peuvent contribuer à un changement global en adoptant une approche élargie de leur mission. Michael Marmot leur propose 3 leviers :
- Élargir leur regard : ne pas se limiter aux symptômes immédiats mais comprendre les déterminants sociaux du patient (conditions de logement, emploi, isolement social)
- Créer des passerelles avec d’autres acteurs : orienter un patient en difficulté vers un travailleur social ou une aide au logement, par exemple
- S’engager dans le plaidoyer : leur voix est particulièrement écoutée par le grand public et les décideurs.
Pr Louise Potvin souligne également l’importance du travail en réseau : « les professionnels de santé doivent être une partie d’un écosystème plus large, en lien avec les ressources locales et les politiques publiques. »
- Quelle approche adopter pour convaincre les décideurs de parler "d’inégalités sociales de santé” et non "d’inégalités de santé” ?
Les pouvoirs publics ont souvent une vision budgétaire à court terme. Or, investir dans la réduction des inégalités de santé permet d’éviter des coûts bien plus importants à long terme.
« Si on ne fait rien en amont, on paiera en aval », rappelle Michael Marmot, citant l’exemple de l’incendie de la Grenfell Tower à Londres, où 72 personnes ont péri en raison de négligences sur le logement social.
Au Québec, la mise en place de services universels (garderies accessibles, couverture bucco-dentaire élargie) a prouvé son efficacité. Cependant, ces acquis doivent être protégés, car les politiques de réduction des inégalités sont fragiles face aux changements gouvernementaux.
« Lorsqu’on se dote de services publics solides et accessibles, la grande pauvreté ne disparaît pas, mais elle est moins destructrice », souligne Pr Louise Potvin.
- Un autre enjeu abordé lors du webinaire est le rôle du racisme systémique dans les inégalités de santé. Un rapport du Grand Londres a mis en évidence 3 formes de discriminations :
- Discrimination directe, impactant la santé mentale des victimes.
- Barrières structurelles, réduisant l’accès aux soins et aux services pour certains groupes ethniques.
- Biais institutionnels dans le système de santé, entraînant des taux plus élevés de mortalité infantile chez les populations afro-caribéennes, par exemple.
Au Canada, la question du racisme structurel reste controversée. L’exclusion historique des populations autochtones en est un exemple flagrant, avec des services de santé souvent inadaptés à leurs réalités. Selon les experts, intégrer la lutte contre le racisme dans les politiques de santé publique est une priorité.
- Si les inégalités de santé sont largement influencées par des politiques nationales, c’est au niveau local que les solutions se construisent. Expérimenter, mobiliser les acteurs et démontrer l’impact des initiatives sont des leviers puissants pour faire évoluer les politiques publiques.
Michael Marmot rappelle sa devise : "faites quelque chose, faites-en plus, faites mieux."
Les territoires ont un rôle moteur à jouer, à condition de ne pas être laissés seuls face aux défis. Le webinaire s’est conclu sur la nécessité de renforcer les outils de coopération entre acteurs locaux et décideurs nationaux. Une approche indispensable pour que la santé publique soit un véritable moteur de justice sociale.
Regarder en replay le Webinaire
- Rôle des ARS en cas de restrictions budgétaires : Quelles marges de manœuvre auraient les ARS si l’État réduisait drastiquement les budgets de santé, notamment en cas de suppression de l’AME ? Quels leviers d’action pourraient-elles mobiliser ?
- Appui des collectivités locales : Quelles collectivités locales pourraient compenser un désengagement de l’État en matière de santé, malgré leurs compétences limitées par rapport aux villes/régions au Canada et au Royaume-Uni ?
- Rôle des professionnels de santé : Comment les professionnels de santé peuvent-ils contribuer activement à la réduction des inégalités plutôt que d’en être les témoins impuissants ?
- Approche systémique des inégalités de santé : Dans un pays où les compétences sont très segmentées, quelles stratégies pourraient faire des inégalités de santé un véritable enjeu de société ?
- Plaidoyer :
- L’intersectorialité est un levier essentiel pour la promotion de la santé, mais reste difficile à faire accepter aux décideurs. Quelles stratégies de plaidoyer ont prouvé leur efficacité pour convaincre et obtenir des financements
- Quels arguments ou leviers sont les plus efficaces pour démontrer que la lutte contre les inégalités de santé est bénéfique pour l’ensemble de la société ?
- Pouvez-vous partager des exemples concrets de plaidoyers efficaces, notamment avec l’implication des professionnels de santé ?
- Quels discours et méthodes ont fonctionné au Canada et au Royaume-Uni pour convaincre les décideurs d’investir dans la santé, notamment auprès de responsables politiques néolibéraux ?
- Reconnaissance et financement des acteurs de terrain : Le renforcement des compétences individuelles et collectives repose sur des actions de proximité menées par des structures hors du champ traditionnel de la santé publique. Comment valoriser leur rôle et obtenir leur financement ?
- Santé et discriminations raciales : Comment intégrer la lutte contre le racisme et les inégalités de santé liées à l’ethnicité dans les politiques publiques, surtout dans un pays où ces inégalités sont peu documentées et la demande sociale d’équité raciale faible ?
- Impact des politiques locales sur les territoires voisins : Les politiques sociales volontaristes menées par certaines collectivités influencent-elles positivement ou négativement les collectivités environnantes moins engagées ?
- Modèles d’aide alimentaire plus efficaces : En France, l’aide alimentaire repose sur la récupération d’invendus, avec des limites en termes de qualité nutritionnelle et de choix. Existe-t-il des modèles plus sains et participatifs ailleurs ?
- Accès à l’information en santé au Burkina Faso : Comment améliorer l’accès à l’information en santé pour éviter des comportements de soins inadaptés ?
- Nommer les inégalités sociales de santé sans stigmatisation : Comment convaincre les décideurs de parler explicitement d’inégalités sociales de santé sans que cela soit perçu comme un sujet polémique ?
- Programmes de développement des compétences psychosociales : Ces programmes sont aujourd’hui mis en avant en France, notamment dans les écoles. Qu’en est-il dans d’autres pays ?
- Littératie en santé : Comment ce concept est-il utilisé comme levier de réduction des inégalités sociales en santé ailleurs, tant au niveau des compétences individuelles que de l’adaptation des systèmes de soins ?
Biographie des intervenants
Le Pr Sir Michael Marmot est un professeur d'épidémiologie à l'University College de Londres, directeur de l'Institut pour l'équité en santé de l'UCL et ancien président de l'Association médicale mondiale. Il a mis en place et dirigé un certain nombre d'études de cohorte longitudinales sur le gradient social de la santé au sein de l'UCL. Il a présidé la Commission sur les déterminants sociaux de la santé (CSDH), créée par l’Organisation mondiale de la santé en 2005, et a produit le rapport intitulé : « Combler le fossé en une génération » en août 2008. À la demande du gouvernement britannique, il a mené l’examen stratégique des inégalités de santé en Angleterre, qui a publié son rapport « Fair Society, Healthy Lives » (également connu sous le nom de Marmot Review) en février 2010.
En 2011, à la suite de la CSDH, il a créé l’Institut pour l’équité en santé de l’UCL (IHE). L’IHE s’efforce de s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé et d’améliorer l’équité en santé. Le professeur Marmot et son équipe de l’IHE ont été chargés par des villes et des régions de mettre en pratique au niveau local leur approche fondée sur des données probantes en matière d’équité en santé. Plus de 40 communautés en Angleterre et au Pays de Galles se sont déclarées agissant selon les principes Marmot. En février 2020, l’équipe de l’IHE a lancé l’étude « Marmot Review 10 Years On », qui met à jour l’étude « Fair Society, Healthy Lives ». En décembre 2020, ils ont publié « Build Back Fairer : The COVID 19 Marmot Review »
Le professeur a également dirigé de nombreux travaux de recherche mondiaux sur les inégalités de santé. Il a notamment présidé la « Revue européenne des déterminants sociaux de la santé et de la fracture sanitaire », pour l’OMS en 2014. L’ONUSIDA l’a désormais invité à coprésider un nouveau Conseil mondial sur les inégalités, le sida et les pandémies.
Le professeur Marmot a été président de la British Medical Association (BMA), titulaire de la chaire Harvard Lown de 2014 à 2017 et a reçu le prix Prince Mahidol pour la santé publique 2015. Il a reçu des doctorats honorifiques de 21 universités. En 2021, le professeur Marmot a reçu le prix BMJ pour sa contribution exceptionnelle à la santé. En 2000, le professeur Marmot a été fait chevalier par Sa Majesté la Reine pour ses services à l'épidémiologie et à la compréhension des inégalités de santé. Il est membre de l'Académie nationale de médecine des États-Unis, de l'Académie brésilienne de médecine et de l'Académie mexicaine de médecine.
Pr Louise Potvin, chercheuse au GRIS (1988-2009) à l’IRSPUM (2009-2019) et au CReSP (depuis 2019), elle a commencé à enseigner au Département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l’UdeM (ESPUM) en 1988. Elle y dirige, depuis 2012, la Chaire de recherche du Canada sur les approches communautaires et les inégalités dans le domaine de la santé. De 2004 à 2016, elle a été directrice scientifique du Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités sociales de santé de Montréal, et rédactrice scientifique de la Revue canadienne de santé publique, de l'Association canadienne de santé publique de 2013 à 2023. Elle est directrice scientifique fondatrice du CReSP depuis 2019. Mme Potvin siège à l’Union internationale de Promotion de la santé et d’éducation pour la santé et a été la présidente du Comité scientifique mondial pour les 22éme et 23éme conférences mondiales de l’organisation.
Reconnue internationalement pour son expertise en évaluation de programmes en santé communautaire, Louise Potvin mène des travaux qui visent à éclairer la prise de décision et les interventions en santé publique dans le but de réduire les inégalités de santé. Son action a contribué à changer les pratiques de recherche au Canada et dans le monde, notamment ses nombreuses collaborations avec l’Europe et le Brésil. Elle est le récipiendaire du prix ACFAS Pierre-Dansereau 2017, du Prix Chercheur pionnier 2021 de l’Institut de santé publique et des populations (ISSP) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) En 2021, elle a reçu le prix R. D. Defries de l'Association canadienne de santé publique (ACSP) en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au vaste domaine de la santé publique. Elle a été membre du groupe de travail OMS-EURO sur l'évaluation de la promotion de la santé.
Le Pr Potvin a co-dirigé le manuel français dédié à la réduction des inégalités de santé, « Réduire les inégalités sociales en santé », édité par l’INPES en 2010. Elle est membre du conseil scientifique de l’INCA et a présidé les comités scientifiques des colloques INCA consacrés à la recherche interventionnelle.