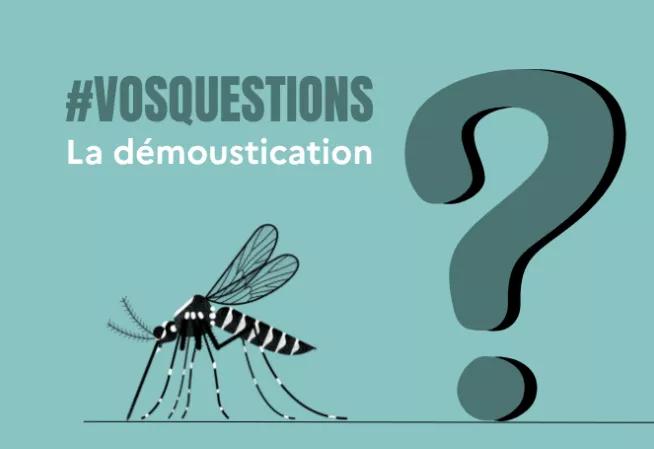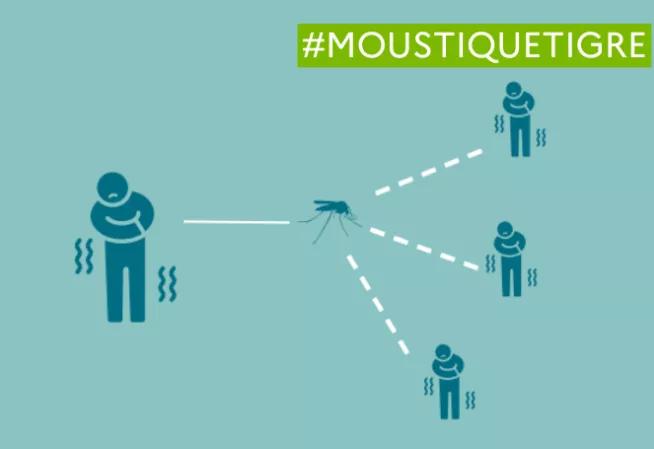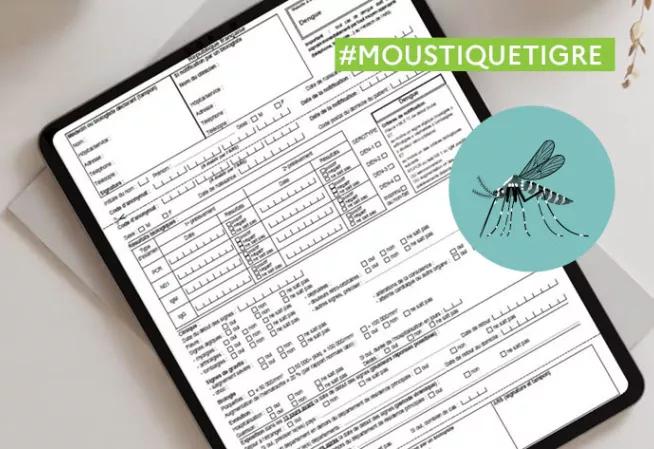Il ne fait pas de bruit, vole bas, pique le jour. En moins d'une décennie, le moustique tigre s’est discrètement imposé dans le paysage francilien, colonisant balcons, gouttières, pots de fleurs et bacs oubliés. Rodé à la vie urbaine, il a d’ores et déjà officiellement colonisé 212 communes d’Île-de-France, soit 68 % de la population régionale. Aedes albopictus, plus communément appelé moustique tigre, espèce invasive en provenance de l’Asie du Sud-Est, est aujourd’hui surveillée comme un risque sanitaire à part entière.
Un vecteur de maladies sous haute surveillance
Car sous ses dehors minuscules, l’insecte est un vecteur redouté de la dengue, du chikungunya ou du Zika. Des maladies nommées arboviroses généralement bénignes mais qui, dans certaines formes, peuvent entraîner des complications graves, notamment chez les personnes fragiles. En 2024, l’Île-de-France a enregistré 584 cas importés de ces arboviroses, principalement durant les retours de vacances d’été (retrouvez le bilan épidémiologique 2024). Parmi eux, un cas de chikungunya autochtone – c’est-à-dire contracté localement, sans voyage dans une zone à risque –, le premier recensé dans la région, a confirmé que la menace n’était plus seulement théorique. L’année précédente, en 2023, un cluster familial de 3 cas de dengue n’ayant pas voyagé, avait également été détecté dans le Val-de-Marne. Plus d’informations dans l’article suivant : https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2023.28.49.2300641
Face à ce risque, l’ARS Île-de-France déploie chaque année un dispositif de surveillance renforcée du 1er mai au 30 novembre, en coordination étroite avec Santé publique France, les collectivités territoriales et son opérateur de démoustication, l’Agence Régionale de Démoustication (ARD). « On ne pourra pas éradiquer le moustique tigre, il est durablement implanté. La priorité, c’est de suivre sa progression, limiter sa densité et surtout casser les chaînes de transmission virale quand elles apparaissent », explique Nicolas Herbreteau, responsable Environnement extérieur à l’ARS Île-de-France.
Ce dispositif repose sur trois volets : la sensibilisation du grand public, des professionnels de santé et des voyageurs de retour de zones à risque, la surveillance entomologique des populations de moustiques et la surveillance épidémiologique des cas humains d’arboviroses. Ces actions permettent de prévenir les risques et de réagir rapidement en mettant en œuvre des mesures de lutte antivectorielle adaptées lorsque cela s’avère nécessaire.
Lorsque l’ARS reçoit la déclaration d’un cas de dengue, de chikungunya ou de Zika, elle contacte la personne pour enquêter sur ses déplacements et définirsa période de virémie (phase pendant laquelle le virus est dans le sang et peut être transmis à un moustique francilien si la personne est piquée, moustique qui pourra alors retransmettre le virus à quelqu’un d’autre, déclenchant ainsi une transmission autochtone). Si cette personne a été virémique en Île-de-France, une enquête entomologique est déclenchée dans un rayon de 150 mètres autour des lieux à risque, c’est-à-dire les lieux fréquentés où la personne a pu être piquée, avec inspection des cours, jardins, gouttières, terrasses, à la recherche d’eau stagnante, de moustiques adultes et de larves. L’objectif est également de supprimer les potentiels gîtes de repos pour les moustiques et éventuellement faire des traitements biochimiques pour éradiquer les larves et/ou moustiques adultes selon le risque sanitaire associé.
Enquête express et démoustication ciblée
« Ces interventions ont pour but de vérifier rapidement si le moustique tigre est présent et dans quelles conditions. Les techniciens identifient les gîtes larvaires, cherchent les formes adultes, et en profitent pour sensibiliser directement les riverains », précise Nicolas Herbreteau.
En 2024, 370 enquêtes entomologiques ont été menées dans la région, donnant lieu à 19 traitements insecticides ciblés. Ces traitements, réalisés la nuit, ne sont utilisés qu’en présence de moustiques adultes confirmés, et uniquement en contexte de risque vectoriel identifié, selon des protocoles et des restrictions d’usages qui s’appliquent durant les traitements. « Il ne s’agit pas de démoustication de confort. Chaque intervention vise à casser une possible chaîne de transmission virale », insiste-t-il.
Une vigilance partagée, du terrain au citoyen
Au-delà des cas avérés, l’ARS coordonne également une surveillance entomologique proactive, avec plus de 500 pièges pondoirs installés dans les communes colonisées ou à risque, notamment autour des établissements de santé et des aéroports : la stratégie est de suivre de front de colonisation. Elle conseille les collectivités dans la gestion des espaces publics, diffuse outils et kits de communication, organise des formations, et relaie la plateforme nationale de signalement citoyen, qui permet à chacun de contribuer à la veille.
Car l’essentiel de la prévention se joue aussi dans les gestes du quotidien : vider les coupelles, couvrir les récupérateurs d’eau, nettoyer les gouttières, porter des vêtements couvrants, utiliser des répulsifs adaptés. « L’implication de tous est indispensable. Le moustique tigre prospère facilement au milieu urbain, il suffit d’un fond de pot de fleur pour qu’il prolifère. Notre rôle est de créer les conditions d’une réponse rapide, coordonnée et partagée à l’échelle des territoires », résume Nicolas Herbreteau.
Focus - Le Vésinet : une ville-parc face à une menace invisible
Avec ses lacs artificiels, ses 7 kilomètres de canaux, ses sous-bois préservés et ses dizaines de milliers d’arbres, Le Vésinet aurait pu devenir un refuge pour le moustique tigre. Mais la commune des Yvelines a choisi d’anticiper. Intégrée depuis 2024 à la cartographie des communes colonisées par l’ARS, la commune mise sur une action globale conjuguant montée en compétence des équipes techniques, action biologique et sensibilisation des habitants.
« Notre ville-parc est un écosystème à part entière, avec ses forces et ses fragilités. La présence du moustique tigre nous oblige à concilier préservation de la nature et protection des habitants. C’est un équilibre subtil, mais indispensable », souligne Monica Lonardi, adjointe au maire en charge des espaces naturels, de la transition écologique et de la cause animale.
L'an dernier, ainsi qu'en avril 2025, les services municipaux ont bénéficié d’une formation centrée sur le moustique tigre, dispensée par l’ARD, opérateur régional de démoustication. Jardiniers et agents de propreté ont appris à repérer et supprimer les gîtes larvaires, à sensibiliser les habitants et à adapter leurs pratiques. Une fiche-action spécifique est en cours de rédaction dans le cadre de l’atlas communal de la biodiversité.
La nature à la rescousse
« La commune s'efforce de favoriser la présence de prédateurs naturels du moustique, comme les grenouilles et les chauves-souris, espèces déjà bien implantées sur le territoire. Leur rôle de régulation biologique fait l'objet d'une attention soutenue, dans une logique de soutien aux équilibres naturels.
Enfin, la ville s’appuie également sur les dynamiques intercommunales. Elle participe notamment au groupe "Nature en ville" animé par la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine dans le cadre du plan Air-Climat, où elle échange avec d’autres villes sur les pratiques et les retours d’expérience en matière de gestion écologique et de santé environnementale.
« Nous voulons aller plus loin : former d’autres agents, associer la population, évoquer la lutte contre les moustiques dans nos événements grand public. C’est un enjeu de santé, mais aussi un levier pédagogique sur la transition écologique », résume Monica Lonardi en conclusion.
Focus - « La rapidité du signalement est un enjeu sanitaire majeur »
Entretien avec Nelly Fournet et Gabriella Modenesi, épidémiologistes, de l'équipe arboviroses de la cellule régionale Île-de-France de Santé publique France
Quel est le rôle de votre équipe dans la surveillance des arboviroses transmises par le moustique tigre ?
Nous assurons l’animation régionale de la surveillance épidémiologique des cas de dengue, chikungunya et Zika et la coordination entre les différents acteurs. Pendant la période de surveillance renforcée, du 1er mai au 30 novembre les cas peuvent nous être remontés via deux canaux : la déclaration obligatoire des professionnels de santé, ou le rattrapage de cas positifs non déclarés à partir des données transmises à Santé publique France par les laboratoires partenaires. Concrètement, nous appuyons l’ARS dans le suivi de l’ensemble des cas signalés en Île-de-France, surtout les cas nécessitant une expertise épidémiologique. Nous travaillons en binôme étroit avec l’ARS. En cas de transmission autochtone, de multiples actions sont déclenchées avec nos différents partenaires (Le centre national de référence des arboviroses, l’agence régionale de démoustication, Santé public France au niveau nationale…). Notre équipe assure également la qualité et la retro information des données issues de la surveillance.
Pourquoi est-il si important d’identifier rapidement les cas ?
Parce que les virus transmis par le moustique tigre – notamment la dengue et le chikungunya – ne sont pas transmissibles entre humains : ils ne se diffusent que si un moustique pique une personne infectée pendant sa période de virémie. C’est cette fenêtre de quelques jours qui nous intéresse (2 jours avant le début des symptômes jusqu’à 7 jours après en moyenne). Si nous ne sommes pas informés à temps, l’enquête est plus difficile, et l’on risque de passer à côté d’un risque réel de transmission autochtone si les enquêtes entomologiques sont déclenchées trop tard. Cela implique d’identifier le cas, de pouvoir le joindre et de retracer ses déplacements très rapidement.
Quel rôle jouent les médecins dans ce dispositif ?
Il est central. Ce sont eux qui peuvent orienter vers un diagnostic en cas de retour de voyage avec des symptômes évocateurs, et qui doivent ensuite faire la déclaration obligatoire. Or on constate encore une sous-déclaration importante, en particulier en médecine de ville. Certains cas passent ainsi sous les radars, ou sont détectés tardivement via les laboratoires, ce qui complique les enquêtes et retarde les éventuelles interventions de lutte antivectorielle. La sensibilisation des professionnels de santé est un levier essentiel.
Que peut-on dire de la situation en 2025 jusqu’à présent ?
Le nombre de cas importés est très élevé pour cette période de l’année, en lien avec les épidémies de chikungunya qui touchent actuellement l’océan Indien, notamment sur les îles de La Réunion et Mayotte. La compétence élevée du moustique tigre à transmettre le virus du chikungunya, en particulier le génotype concerné par ces épidémies, et la forte pression d’importation nous pousse à une vigilance accrue. Six transmissions autochtones ont d'ailleurs été identifiées dans d’autres régions (Occitanie, PACA, Corse et ARA) par Santé publique France depuis le début de la période de surveillance renforcée, ce qui est très précoce pour un début de surveillance…